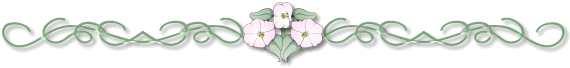|
Le thermalisme (Lacustre)Le thermalisme est sans contredit la
pratique touristique par excellence du XIXe siècle, même
si la quête de paysages nouveaux ou de "curiosités" n'est
pas la motivation première du voyage. Plus que de voyage
d'ailleurs doit-on parler de séjours longs dans lesquels les
bienfaits des eaux se combinent au climatisme, aux plaisirs mondains et
aux distractions de toutes sortes pour assurer la guérison du
baigneur. Comme sur le pourtour des Alpes la Savoie est riche en
sources thermales et minérales, beaucoup ayant été
redécouvertes au XVIIIe siècle et certaines étant
devenues des lieux attractifs pour l'élite européenne et
les familles régnantes dès la fin de ce siècle. En
particulier certaines au bord des lacs. Evian en est un bon exemple qui
succéda en notoriété à Amphion, lieu
habituel de cure pour la famille royale de Savoie jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle. Après la découverte des
bienfaits de la source Cachat en 1790, le premier établissement
thermal ouvre en 1826 et la station ne tardera pas à attirer "les
notabilités les plus diverses de l'aristocratie, de la finance,
de l'art, de l'industrie ou de la politique venues pour oublier les
soucis de la vie et les tracas du monde" (le Guide d'Evian, 1866).  Le thermalisme joua un rôle non
négligeable dans la renommée touristique de la Savoie
sans que l'on puisse dire pour autant qu'il fut un des vecteurs
essentiels du développement du tourisme
lacustre. Dans le cas du Léman "c'est le facteur
intellectuel qui a été le vrai stimulant du tourisme
proprement lémanique" (P. Guichonnet, 1988). Architectures du tourisme thermalLe chemin de fer a fortement contribué au développement du thermalisme. Si les sources étaient connues depuis l’Antiquité, l’industrie thermale ne se développe vraiment en Savoie qu’à partir du XIXe siècle. De nouvelles sources sont découvertes et les stations se multiplient : Aix-les-Bains, Evian, Thonon, Saint-Gervais, Challes, Brides, Salins … sans compter celles qui ne sont plus exploitées comme Coise, La Caille, La Bauche … La ville d’eau n’attire pas que les curistes, elle constitue un voyage d’agrément. Cela est surtout vrai pour les grandes stations, Aix-les-Bains et Evian qui hébergent une clientèle aristocratique et mondaine. Il ne faut pas seulement construire des thermes mais aussi des hôtels luxueux, des villas spacieuses pour les loger mais aussi des casinos, des théâtres, des jardins pour la distraction.EVIAN  le Splendide, le Royal, le
Grand-Hôtel, et plus tard le Grand hôtel des Bains devenu
célèbre au moment de l'indépendance de
l'Algérie, sous le nom d'Hôtel du Parc...
L'établissement des bains, l'approche des sources et des
buvettes se modifient peu à peu. L'eau de pluie ou de fonte des neiges est recueillie, sur les contreforts du Chablais, par une couche de sables glaciaires, enserrée entre deux plaques de moraines argileuses. Ce sable joue le rôle d'un immense filtre naturel qui donne à l'eau sa minéralité caractéristique. Parcourant 100 à 300 m par an, l'eau d'Évian surgit 15 ans plus tard à une température constante de 11,6 °C. Maladies rénales ou des voies digestives, fatigues nerveuses, telles furent les premières indications des eaux d'Évian, que l'on se procurait d'abord exclusivement dans les pharmacies. En 1960, Évian entre dans l'ère de la grande distribution et la célèbre bouteille à l'étiquette rose apparaît dans les supermarchés. Aujourd'hui, Évian est le premier exportateur mondial d'eau minérale (4 millions de bouteilles par jour) Les premiers bains d'Évian sont ouverts, dans une demeure privée, en 1824. Deux ans plus tard, le roi de Sardaigne accorde une autorisation d'embouteillage avant que ne débute en 1827 la construction de l'établissement thermal. La Société des eaux d'Évian, constituée en 1869, fore de nouvelles voies de captage, acquiert de nouvelles sources. En 1878, l'Académie de médecine donne son approbation et, en 1902, la relation entre l'ingestion d'eau pure et l'amélioration du fonctionnement rénal est mise en évidence. La même année, un nouvel établissement thermal est inauguré. La source Cachat sera reconnue d'intérêt public en 1926. THONON C'est le 22 juin 1864 que l'Etat déclarait la source de la Versoie d'intérêt public et en autorisait l'exploitation. Thonon est devenu une charmant ville d'eaux :  le nouveau boulevard de la Corniche possède son établissement de bains, des hôtels, un casino, tout comme Evian. AIX -le caldarium ou bain d'eau chaudeNous pouvons voir les ruines des thermes romains. Entre de petites colonnes en briques, arrondies ou carrées circulait l'eau chaude. La vapeur montait par des trous dans le sudatorium. Il reste aussi le bassin et les marches de la piscine d'eau chaude. L'eau des thermes nationaux d'Aix-les-bains provient d'une source d'eau naturellement chaude sous le Mont de la Charvaz, tout au bout du lac du Bourget. Elle passe sous le lac, à 2000 mètres de profondeur, et ressort à Aix. Elle est alors à 46°. Il en sort une très grande quantité par jour: 4 millions de mètres cubes. Les Romains restent environ 300 ans à Aix. Ils en sont chassés par les Barbares qui détruisent la ville et les thermes. On ne les retrouve que 1000 ans plus tard. C'est Victor Amédée III qui les remet à la mode. On les reconstruit en 1783. On vient alors à Aix pour prendre les eaux. En 1860, quand la Savoie devient française, Napoléon III qui est empereur de France, vient en visite à Aix-les Bains avec sa femme Eugénie. Il fait un don important pour agrandir et moderniser les thermes. De 1854 à 1860 de nouveaux thermes conçus par Bernard Pellegrini dans un pur style néo-classique remplacent ceux édifiés à la fin du XVIIIe siècle. En façade arcs et colonnes doriques sont utilisés avec une symétrie rigoureuse. L’intérieur s’organise autour d’un escalier monumental d’où partent des couloirs galeries distribuant des espaces plus réduits aux éclairages zénithaux, autre référence à l’Antiquité. Ce bâtiment initial a été agrandi à deux reprises au cours du XIXe siècle. C’est également Bernard Pellegrini qui réalisa les thermes de Marlioz dont subsiste le portail intégré dans le nouveau bâtiment édifié en 1981.  Le casino du grand cercle, conçu
par le même architecte encore a été achevé
en 1849. Ce bâtiment a été remanié et
complété au cours du siècle. En 1878 Samuel Revel
construit deux pavillons à l’est du bâtiment et un
parisien Eustache y ajoute un théâtre à l’italienne
en 1897. La décoration intérieure est somptueuse.
Coupoles et voûtes sont recouvertes de mosaïque. La
voûte du hall du grand cercle est décorée en 1883
par Antonio Salviati (1816-1890), promoteur de la renaissance de la
mosaïque monumentale vénitienne. D’autres salles sont
décorées par Cavaillé-Coll en 1906 dans un riche
style Art Nouveau alors en vogue. Cette eau thermale contient du souffre et des algues microscopiques; elle soigne les rhumatismes. La mise en tourisme des lacs de SavoieLes lacs, comme la montagne d'ailleurs, peuvent être considérés tout d'abord comme un complément à la cure. Cela fut particulièrement vrai à Evian où un quai-promenade commença à être aménagé en 1865 permettant la flânerie au bord du lac (Y. Tyl, 1997), les rencontres, l'observation du mouvement des bateaux et la jouissance du "beau paysage lacustre". Lac-décor offrant un atout supplémentaire à la station dans la mesure où les sensibilités esthétiques s'ouvraient à ce type de paysage. Lac-décor que l'on pouvait également parcourir en barques pour découvrir d'autres perspectives, accéder à certains lieux peu accessibles (Hautecombe sur le lac du Bourget par exemple), voire pour s'essayer à l'aventure lacustre à la suite de Byron et Shelley sur le Léman (leur fameux tour du lac à la voile de 1816), de St Preux emmenant Julie près des rochers de St Gingolph, ou bien de Lamartine sur le lac du Bourget qu'il fréquenta à l'automne 1816 et qui lui inspira une partie de son œuvre, contribuant ainsi à en faire l'archétype du lac romantique. Bien avant que la notion de sport n'investisse les pratiques lacustres, la simple promenade en barque, à rame ou à voile, intégra le lac au territoire du tourisme et des loisirs. La navigation à vapeur accentua le processus, si bien que les débuts d'une navigation non directement utilitaire (c'est-à-dire non vouée exclusivement au transport de marchandises ou à la liaison entre les différents ports) peuvent très bien être considérés comme l'indicateur d'une mise en tourisme des lacs proprement dits. Au départ les deux aspects s'imbriquent cependant. Le Léman est le premier lac à s'essayer à la navigation à vapeur avec le Guillaume-Tell, lancé le 28 mai 1823 et pouvant transporter 200 passagers. L'idée vient de l'extérieur puisque son promoteur n'est autre que le consul des Etats-Unis à Paris, Edward Church étonné de voir que ce genre de navigation n'existait pas sur le Léman alors qu'elle se développait dans son pays depuis les débuts du XIXe (P. Guichonnet, 1988). Ce "pyroscaphe", ou "barque à feu", selon l'expression forgée lors de l'invention de ce type de moyen de transport, avait comme objectif de réaliser la liaison commerciale entre Genève et Ouchy (Lausanne). Cependant des croisières touristiques furent organisées le dimanche et le lundi, croisières qui durent rencontrer un succès certain puisque dès 1824 une seconde société se lançait dans la navigation à vapeur en mettant à l'eau le "Winkelried". Durant les années suivantes, plusieurs sociétés virent ainsi le jour dont, en 1855, une société à Thonon (la société du Chablais de bateaux à vapeur sur le lac Léman), et ce jusqu'à la constitution en 1873 de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, compagnie suisse qui demeurera seule dans cette activité jusqu'à aujourd'hui.  L'expérience fit école sur les autres lacs. Au lac du Bourget un service régulier de liaison en bateau à vapeur entre le Bourget, Aix et Lyon se met en place dès 1838, avec des hauts et des bas, jusqu'à ce que des problèmes de franchissement du Canal de Savières et, surtout, la concurrence des chemins de fer (le raccordement du chemin de fer "Victor-Emmanuel" avec le réseau français à Culoz se fera en 1858), ne mettent définitivement fin à cette navigation commerciale. Le recentrement de l'activité se fera alors exclusivement sur la navigation touristique à l'intérieur même du lac du Bourget, et ceci à partir des années 1860. Même évolution sur le lac d'Annecy. Le premier vapeur lancé en 1839 (le "Chérubin") remorquait une grande barque pouvant contenir une centaine de personnes avec, là aussi, des hauts et des bas. Il faudra attendre l'Annexion de la Savoie à la France et la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie en 1860 pour que la région annecienne commençât à s'ouvrir quelque peu au tourisme. La "couronne de Savoie", cadeau de l'Empereur et pouvant transporter 400 passagers, fut mise à l'eau en 1861 "pour faire le service sur le lac". Mais ce n'est qu'en 1873 qu'une "compagnie de navigation sur le lac d'Annecy" est fondée, compagnie qui assurera la liaison entre les différentes communes riveraines ainsi que la navigation touristique en lançant plusieurs unités (de plus en plus grosses) au tournant du siècle. Peu de temps après (1875), les "étrangers" commencèrent à séjourner dans cette région, alors qu'auparavant ils ne faisaient qu'y passer la journée. Sur les lacs d'Annecy et surtout sur le Léman, la période faste de la navigation touristique à vapeur se situe entre la fin du XIXe siècle et 1914. Les capacités de transport en passagers des bateaux ne cesse d'augmenter. A Annecy on atteint une capacité de 700 passagers avec le "France" (1909). Sur le Léman les bateaux-salons à deux ponts avec décors luxueux, confort raffiné, service à bord peuvent contenir chacun entre 1000 et 1600 places (le "Mont-Blanc" par exemple, lancé en 1875).  La clientèle est présente grâce à l'essor des villes d'eaux lémaniques. Les palaces et hôtels de luxe fleurissent, aussi bien dans les stations thermales que dans les villes, même si le projet Saturnin Fabre "d'organisation d'une station d'été à Annecy" (1899) n'aboutira pas. Le Royal-Hôtel à Evian (1909), 680 chambres "à l'instar des goûts anglo-saxons" (Y. Tyl, 1997), le Splendide à Aix (1884), le Bernascon, le Mirabeau, le Beau-Rivage sur les bords du lac d'Annecy (1899), l'Impérial Palace (1913), dénotent l'attractivité des régions lacustres savoyardes pour la haute société de l'époque. "La fête parisienne se déplaçait chaque année sur le bord des lacs" (Y. Tyl, 1997). La capacité d'accueil, en lits d'hôtels, voire en villas "meublées", bien modeste pour certains lacs comme celui d'Annecy par exemple (9 hôtels en 1860), augmente, en liaison avec le développement des moyens de transport, l'accessibilité des régions lacustres, l'effort de promotion touristique. Dès 1820 des "guides du voyageur", nouveau genre de littérature touristique, vantent les charmes du Léman. Le guide Richard de 1839 ("guide de l'Etranger à Aix en Savoie") donne toute indication pour un séjour réussi dans la station. En 1852 Jules Philippe, à la suite d'Eugène Sue et de sa "Marquise Cornélia d'Alfi", publie "Annecy et ses environs". On y vante les curiosités, les excursions, les agréments de séjour. Mais c'est surtout grâce à l'initiative locale et à la création des Syndicats d'Initiative que s'élabore, pour les stations non thermales, une véritable politique de promotion touristique. En 1895, à la suite de celui de Grenoble et quelques mois avant celui de Chambéry-Aix-les-Bains, Annecy crée son Syndicat d'Initiative. Il ne cessera d'œuvrer pour l'embellissement de la ville, le développement des divertissements (entre autres pour retenir les baigneurs d'Aix qui "ne font que passer à Annecy"), l'amélioration des conditions d'accueil. Les résultats seront assez spectaculaires dans ce dernier cas puisque le nombre "d'étrangers" à Annecy passera de 7'000 en 1897, à 12'000 en 1898 et à 36'000 en 1904, alors que les "touristes-curistes" seront 40'000 à Aix en 1913 et 13'000 à Evian en 1911 (Y. Tyl, 1997). L'attrait du paysage lacustre et du bon air est évident; la contemplation, un élément central de la pratique touristique d'alors, que ce soit au bord ou sur le lac. Cependant, de nouvelles pratiques sont en germe qui ne tarderont pas à centrer le tourisme sur les qualités mêmes des plans d'eau.
|
|
|