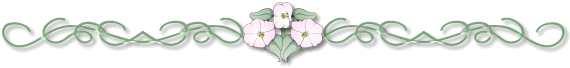|
De nos jours, malgré les efforts méritoires de nombreux groupes patoisants et même d'instituteurs et de linguistes attachés à leurs traditions, le patois n'est plus guère parlé que par des personnes agées. Notre patois dit franco-provencal était une langue parlée et non écrite, de plus il variait de vallée en vallée. La première règle à respecter dans notre français local, c'est la prononciation des mots, et les tout premiers mots à prononcer comme il faut, ce sont les noms propres de personnes ou de villages terminés par OZ ou AZ, ou EX. Difficile de savoir la prononciation correcte des mots terminés par ENS. Ce z final ne s'est en fait jamais prononcé : il servait à indiquer que le -a des noms féminins et le -o des noms masculins étaient atones, autrement dit que l'accent tonique devait porter sur l'avant-dernière syllabe. Ainsi, un nom comme La Clusaz devrait, à quelques nuances près, se prononcer "la Clusa". La plupart des noms de famille terminés par -az sont des toponymes (noms de lieux). Ainsi Chappaz, l'un des noms les plus portés en Haute-Savoie, ne désigne certainement pas le porteur d'une cape ou d'un manteau, comme on le lit généralement dans les dictionnaires. Même si la racine est la même que pour "chape" (le latin cappa), c'est un terme désignant une grange, une remise (cf. le hameau de la Chappaz à Magland, en Haute-Savoie). De la même façon Combaz évoque un vallon, Bordaz une ferme, Perrollaz un lieu pierreux, tandis que Detraz et Deletraz, issus du latin strata, désignent la maison située près de la route. Le -z final n'a parfois aucune justification réelle, comme dans Dupraz (= Dupré), où l'accent tonique porte sur la dernière syllabe. Par contre il se justifie dans Servaz (= la forêt), un nom qui présente une évolution phonétique intéressante : le [l ] devant consonne s'est transformé en [r], phénomène que l'on retrouve dans des noms comme Charvet, Charvin, issus du latin calvus (= chauve). Parmi les patronymes les plus portés, on trouve pas mal de noms de métiers, avec des particularités phonétiques ou graphiques elles aussi explicables par le francoprovençal. Le forgeron s'appelle ici Favre, et non Fabre comme en occitan ou Fèvre comme en français : autrement dit, on a conservé le [a] latin de faber, comme en occitan, mais le b intervocalique s'est transformé en [v], comme en français. Le passage de [b] à [v] se retrouve dans le noms Lavorel (= laboureur). Sans chercher à approfondir les règles phonétiques, on remarquera que le meunier devient en Savoie Mugnier, que le charpentier s'appelle Chappuis et le tisserand Tissot. Un autre nom savoyard très répandu, Métral, évoque pour sa part la fonction de bailli, représentant du seigneur dans le village. Revenons à la toponymie avec quelques noms typiques du francoprovençal : ainsi Mollard (variantes Molard, Dumolard) désigne un talus, une butte, Perrier et Murgier un tas de pierres, Dunand une vallée, un ravin (penser à Nantua dans l'Ain), Ducret un sommet montagneux, Chavanne une cabane. Bien entendu, de nombreux noms de personne (ou prénoms) figurent au rang des patronymes les plus répandus. C'est le cas en Haute-Savoie pour Baud, issu du germanique Baldo (racine bald = audacieux), ou encore pour Gay, qu'il faut sans doute rattacher au latin Caius. Ceci nous amène à évoquer une autre particularité savoyarde, les noms de famille composés. Dans un pays de vallées coupées les unes des autres, on s'est retrouvé dans chaque village avec des dizaines de familles portant les mêmes noms, qu'il a bien fallu différencier les unes des autres par l'ajout d'un second élément, surnom ou nom de l'épouse selon les cas. Il suffit de s'arrêter dans un village devant le monument aux morts pour constater la fréquence du phénomène. Un exemple avec le nom Blanc, l'un des plus répandus en Savoie : parmi les noms les plus courants, on notera Blanc-Garin, Blanc-Gonnet, Blanc-Pattin, Blanc-Tailleur, Blanc-Talon, Blanc-Travaillon. GlossaireA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zune ABADÉE = sévère remontrance. s'ABADER = se mettre en train, se remuer, se lever.ABONDANCE = Ancien nom de la betterave fourragère, la "racine d'abondance". ADIEU = dire bonjour à celui qu'on connaît bien, salutation. d' ABORD = Tout de suite , bientôt. un AGASSIN = un cor au pied, durillon. APONDRE = ajouter, allonger, attacher. AULP = alpage. ARSOUILLER = mal recevoir, ou reprendre durement quelqu'un. ARVI ou A'RVI PA = au revoir. les ATRIAUX = Boulette d'abats de cochon hâchés, enveloppée dans la "toile" (péritoine de l'animal), cuite à la poêle. Mets local très populaire en Chablais et Faucigny. AVOUANER = gronder avec vigueur, accabler de reproches, secouer. un BABAN = Nigaud, dadais. Ce terme est un mélange d'affectueux et de péjoratif. BADER = Se promener en badaud. Ne restez pas à bader comme ça. Perdre son temps. un BAGOLU = un ivrogne, dissipateur, farfelu. des BAGNOLETS = récipients larges et ronds mais peu profonds. la BALME ou
BALMETTE = une grotte. un BAMBOUÉ = un fanfaron bruyant ou pauvre type raté. BARJAQUER = Bavarder, faire des commérages. Se dit surtout des femmes. la BAROTTE ou
BÉROTTE = la brouette. le BEROT = luge montée sur roues. (latin bi rota; 2 roues). une BARJAQUE = une femme très bavarde. une BÉNETTE = sorte de hotte pour porter la terre ou le fumier. une BEUFERIE = grossièreté. du BIDOYON = du cidre. un BOBET = un simple d'esprit. le BOËDET = la soue à cochon. les BOGNETTES = dessert de fêtes. une BOILLE = Récipient en fer étamé, puis bidon d'aluminium, pour livrer le lait à la fruitière. Par métaphore : Boillu : qui a un gros ventre BOTOILLON = une bouteille ou flacon. BORLER = crier, pousser des hurlements. BORNALER = tonner. le BOUCHET = lieu garni de bosquets. le BOUILLI = Nom local du pot-au-feu, terme français, qui fait plus recherché. un BRAFAGOILLE = celui qui brasse dans les flaques : un bon à rien. un BRIN-NÉ = un fou (une brinnée = une volée de coups). BROSSU = décoiffé. un CABIOLON = petite pièce sombre, cagibi, débarras. un CACANIOLET = un homme maniaque, tatillon, lent, mou. un CACATI = un cacatier, cabane de WC, dépotoir. ÇA S'EST EU VU = on a vu ou connu autrefois. CAOUÉ = crotté,
mouillé. un CAÏON = un cochon, un porc. CHARCLER =
tailler dans le vif. CREULER = trembler, grelotter de froid ou de
peur. une CHOPINE = un pichet de vin. le CHOSAL
= maison en ruine. un CH'NI = un
endroit en désordre. COFFE = Très employé, mais en Haute-Savoie seulement. sale, couvert de taches. Coffeyer, ou confeyer : salir la COMBE = vallée en flanc de montagne. le CORTI = jardin, potager. le COUÈCLE = couvercle (de marmite). un COUENNEAU = Première planche obtenue apr le sciage d'une bille de bois. Elle est plate sur une face et arrondie sur l'autre, qui garde l'écorce, la couenne, du tronc. On s'en sert pour faire des revêtements extérieurs de constructions rustiques. le CAQUELON = Terme Suisse-romand, devenu très courant en Savoie. C'est le poêlon de terre cuite, pour faire la fondue au fromage. un CARRON = Brique de terre cuite, dont on se servait pour chauffer les lits. un CRÉ = une pente. les
CROETS
= les enfants les
CROZETS
= petites pâtes carrées, souvent au sarrasin CRU = atmosphère froide et humide. CUPESSER = culbuter, tomber. DES FOIS = employé improprement à la place de
parfois. les DESSOUS = les sous-vêtements. un DIOT = saucisse, généralement cuisinée au vin blanc. DRÈ = tout droit. ÉBOUELLÉ = esquinté, abîmé. une ÉCAMBÉE,
CAMBÉE = une enjambée. ÉDIOFÉ = écrasé, coincé, abîmé. ÉJARATTER = remuer frénétiquement bras et jambes s'ÉMOURGER = se remuer, bouger. une EMPLATRE = individu lent et maladroit. Soufflet violent.Je lui ai foutu une emplâtre.
EMPLATRER =
entrer en colision. ENCOUBLER = gêner, entraver. ENFATTER = mettre dans la poche ou la fente,
remplir, grossir. s'ENJOQUER = s'étouffer avec des aliments bourratifs. ÉPEUFER = repousser
violemment. ÉPOULAILLÉ = être
effrayé, ébouriffé. ESSORBALÉ
= être perturbé, secoué. FAIRE DES
GÔGNES = faire des
manières ridicules. FAIRE LA POTTE = bouder. FAROILLON = personne qui bricole sans soin. le FAYARD =
le hêtre, il peut atteindre 40m de hauteur avec un tronc remarquablement droit et lisse. Il vit 200 à 250 ans une FÉNOLE =
une femme, une épouse les FINS =
terrains ayant une bonne terre. un FION = un mot blessant, un
pique, moquerie. le FREDI = Ancêtre du frigo conservait produits laitiers et salaisons le FRETI = le fruitier,chargé de la gestion de la fruitière (v.ci-dessous) la FRUITIÈRE = coopérative laitière.
un GNAGNIOU = Personnage un peu simplet et hésitant, qui traîne à s'exprimer et à se décider.
une
GUIDAULE
= une petite bande de terrain étroite. un GNAGNIOU = un individu simplet ou qui a du mal à se décider. la
GNIA =
troupe, nichée, famille nombreuse. des GOGNES = faire des manières, des embarras. une GOUILLE = flaque, creux remplis d'eau. la GOUTTE = eau de vie. un
GORGEON =
une gorgée d'alcool. GRÉMOTTU = rugueux. GREULER = se promener et rentrer en retard,
flâner, traîner. GRINGE = Grognon, grincheux. GROMAILLER = casser des noix pour les manger ou en
faire de l'huile. GUINGALLER = Boiter, être bancal, instable.
des
HERBETTES = Fines herbes (persil, cerfeuil, thym, etc.) INALPAGE = Séjour des bergers et du troupeau aux alpages pendant la saison estivale. JAPPE = organe de la parole. Du français japper, « pousser des petits aboiements ». JARCLER = dégager le plancher
brutalement. KATIFLE = En Chablais, pommes de terre.
la LAUZE =
pierre taillée utilisée pour couvrir les toitures, remplace la tuile, l'ardoise MAFFI = Fatigué. On est revenu à pied et on est tout maffi. MAIS = Un des termes savoyards les plus typiques et les plus répandus. Derechef, encore.
Il est mais là. Ça y est mais. J'ai mais dû me gendarmer. "On peut reconnaître un Savoyard à la manière dont il use et abuse du terme mais". Se prononce mé. une MANOILLE = anse d'un pot ou une petite manivelle. MATAFAN =
crêpe épaisse à base de faine,oeuf, lait, coupe-faim MÉ = encore, de nouveau, exemple : il est
mé revenu. MODER ou
S'EN
MODER = partir, s'en aller. MOINNER = ronchonner, geindre, se plaindre. le MOLLARD =
une colline. les
MOGES
= les génisses. un MOGEON =
petit veau, ou moquerie envers une
fille pas très belle. un MOULE =
mesure de volume de bois, variable selon la vallée. un NANT = un torrent, un ruisseau. la NIA =
troupe, nichée, famille nombreuse. avoir la NIARD = être de mauvaise humeur. des NIÔLLES = des nuages, brume, brouillard. NIOLLU ou
NIANIOU = personne molle sans énergie. il y a NION = il y a personne. la OUAFFE =
neige fondante. une PANOSSE
= Un des savoyardismes les plus communs. Serpillère servant aux nettoyages du sol. Par analogie, personne molle, apathique. la PATIOQUE =
de la boue épaisse. PATROUILLER = tripoter. un PATTIER = un
chiffonnier, un brocanteur, ramasseur de pattes. une PÉTOLE
= une petite crotte, petite chose, ou familièrement petit enfant. la PEUFE = la poussière, salissure. la PEYANDRE = désigne la peau blanche, les nerfs ou le gras de la
viande. les PLANS = lieux assez plats. les PLANANS = les habitants de la plaine. PI = seulement. Va pi (Va seulement) la PIAUTE = la jambe. PIOULER = crier (ou parler) d'une voix aiguë. une POLAILLE = une poule, une volaille. un POUÈ = un porc, un cochon. les PRAZ = les prés. une QUINQUERNE =
1. Vielle à roue. Patois savoyard kinkerne, peut-être du patois cancorna, « hanneton », à cause du bruit continu qu´il produit. une RAJOUTURE =
RAPONSE = quelque chose de rajouté. RATASSER = farfouiller ou se répéter. les RATTES = les dents de lait des enfants. REBLOCHON =
fromage savoyard fait
de lait gras. un RHABILLEUR = rebouteux, qui remet les membres démis. RINGALER = traîner, lambiner. être à la RÔDE = être
en chemin, se promener. Faire la RIOULE = faire la
fête hors de chez soi. une ROILLÉE = une forte pluie. SACOGNER = secouer brutalement. un SÂPI = pic de bûcheron pour les billons de
bois. une SASSON = une grosse bécasse, une
nigaude, femme lourde. une SNYULE = manivelle ou personne qui radote et se répète. un TABANNÉ = individu un peu fou et parfois dangereux. la TARTIFLE, KATIFLE = pomme de terre. un TÂTA-CUL
DE POLAILLE = une personne
trop tatillonne et pénible. un TATU ou
TOURET = désigne quelqu'un de borné, têtu. un TAVAILLON = tuile en bois de 40 par 15 cm. aller TÔ PLAN = marcher tout doucement, tranquillement. une TOMBÉE = petite quantité de liquide, on dit aussi : un
doigt, une larme. une TORGNAULE =
une correction
patriarcale. TOUCHER LA MAIN = serrer la main à quelqu'un. le TOUPIN = pot en terre vernissée. la TOUPINE = jarre en terre d'une contenance de 8 à
10 litres. l' UBAC =
Versant d´une vallée exposé au nord. la VAUDAIRE =
Lac Léman : fort vent du sud-est dans le Haut-Lac et du sud-est à est dans le Grand-Lac. Son nom est vauvaire à Saint-Gingolph, et vient de *vauthaire, du latin *vallesaria, « [vent] de la vallée » des VIROLETS = des petits virages serrés en montagne. la VIULA =
Vieilli : vielle, sorte de mandoline dont les cordes sont frottées par une roue actionnée par une manivelle. la VOGUE =
fête patronale de la commune. Retour de vogue : prolongation de la fête le dimanche suivant.
VOIR =
Apporte une nuance au verbe principal. *** RAS *** *** RAS *** l' Y [pronom] =
Ce pronom remplace le, la ou les dans un très grand nombre d´expressions. *** RAS *** Pour les femmes, le prénom est précédé de l'article. On se sert souvent du diminutif et, à la campagne de la forme patoise : la Glaudia, la Césarine, la Fine, (Joséphine), la Foëse (Françoise), la Mya (Marie), ou encore du sobriquet de la famille : la Polalyire (la "Poulaillère"). Yé la boëba la Clémentina à Fanfoua à Collet. C'est la gamine à la Clémentine à François à Collet. Difficle à comprendree , quand on ne sait pas que ma grand-mère Clémentine était la femme "à" François, dont le surnom familial était Collet. Toute proposition ou commentaitre est bienvenu : Adresser le courriel à : Jean-Claude |
|
|